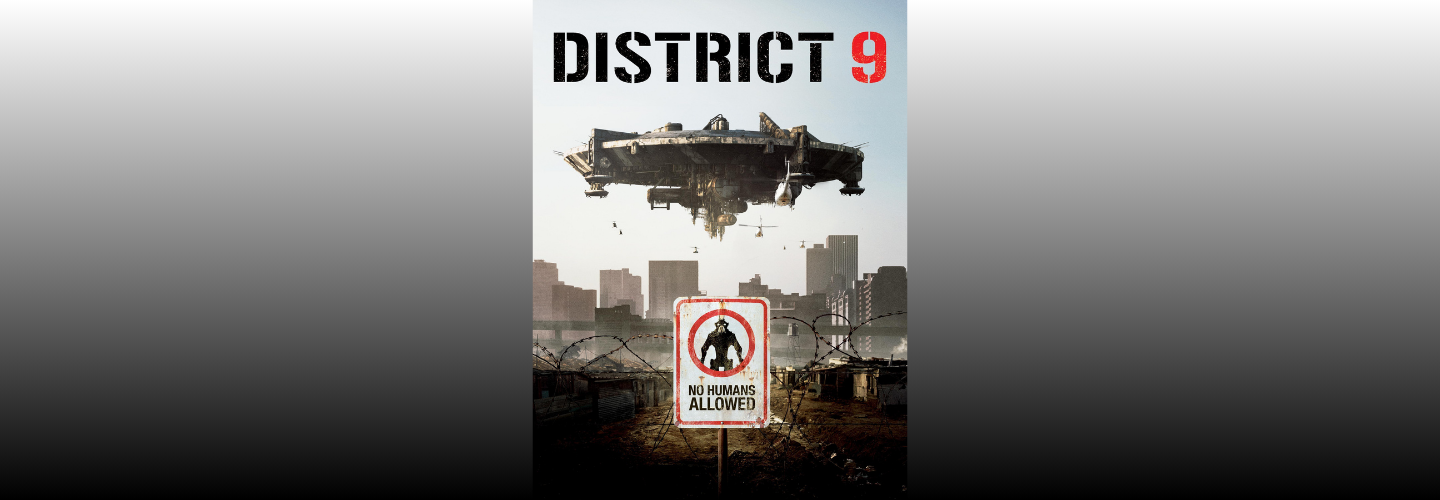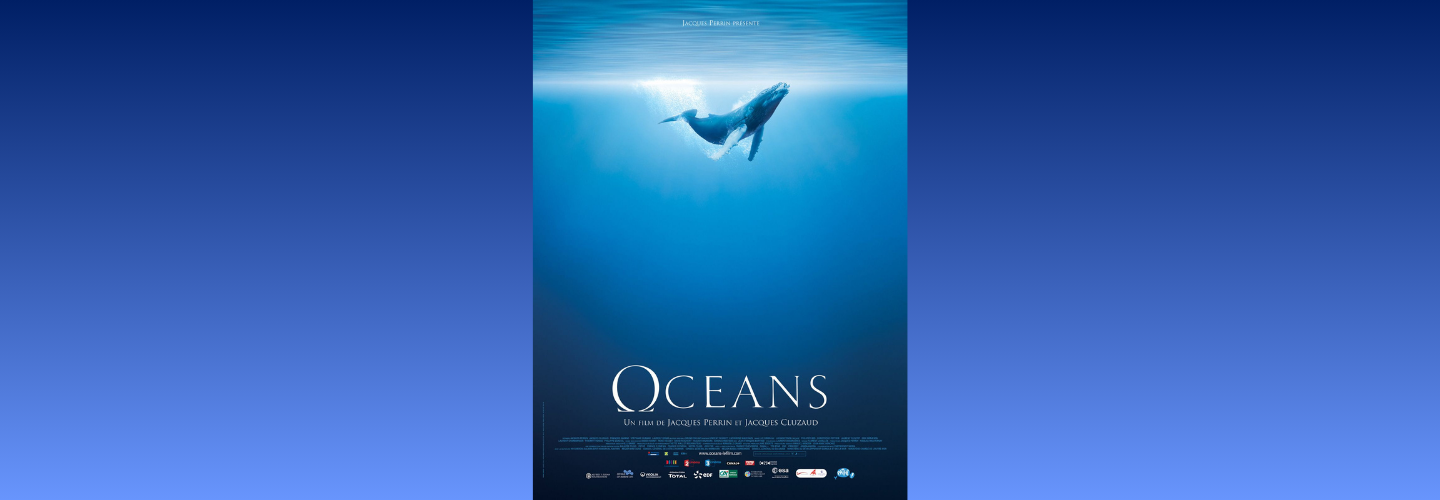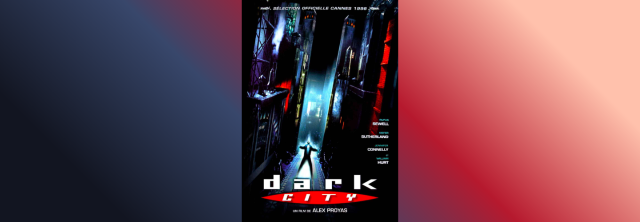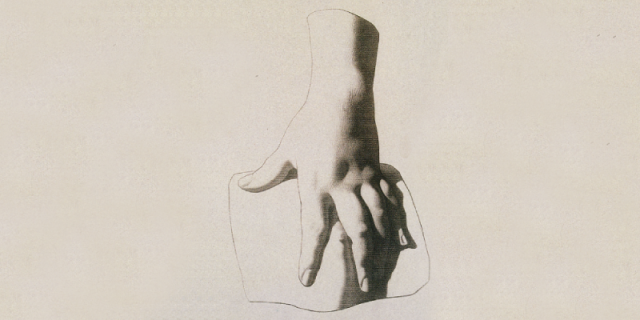- Détails
- Catégorie : Cinéma
Il y a 28 ans, des extraterrestres entrèrent en contact avec la Terre...
Ces "visiteurs" étaient des réfugiés et furent installés dans le District 9, en Afrique du Sud, pendant que les nations du monde se querellaient pour savoir quoi en faire...
Sécurité. Pour accéder au portail de votre bibliothèque, merci de confirmer que vous n'êtes pas un robot en cliquant ici.
- Détails
- Catégorie : Cinéma
Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en chasse, accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire... Le film Océans c'est être poisson parmi les poissons.
Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin nous entraîne, avec des moyens de tournage inédits, des banquises polaires aux tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes pour nous faire redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées.
Océans s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage et répond par l'image et l'émotion à la question : “L'Océan ? C'est quoi l'Océan ?”
(Texte Allociné)Sécurité. Pour accéder au portail de votre bibliothèque, merci de confirmer que vous n'êtes pas un robot en cliquant ici.
- Détails
- Catégorie : Cinéma
La terre sans êtres humains.
Le monde semble n’avoir jamais été aussi paisible. Peu d’indices sur la nature de la disparition, ni sur la durée depuis laquelle nous avons disparu. Nous ne sommes plus, tout simplement. Nous avons laissé derrière nous quelques traces : des statues, des villes, des bateaux, des bricoles.
Mais ces lieux familiers ne sont pas hantés pour autant, pas inquiétants pour deux sous, car ils sont toujours habités ; habités par leurs nouveaux hôtes, le peuple animal. En particulier Flow, charmant chat noir charbon au pas chaloupé mais pas chaud des chaloupes. Car de chaloupes il va vite être question, quand l’eden sans humains se trouve menacé par une inondation aux proportions bibliques. Flow manque de périr noyé et survit de justesse, embarqué dans une aventure maritime aux côtés d’autres compagnons d’infortune. Au fur et à mesure du film, il va devoir affronter sa peur de l’eau, manifestée à l’écran par une baleine tantôt cauchemardesque, tantôt amicale.
Authentique joyau de film d’animation, Flow montre qu’aujourd’hui il n’est pas nécessaire d’avoir un budget géant et des armées d’animateurs sous-payés pour réaliser un chef d’œuvre. Les textures au photoréalisme relativement bas tranchent avec la mode actuelle de la haute-fidélité, le réalisateur ayant privilégié un réalisme du mouvement (les animaux étant animés avec un naturalisme saisissant) à un réalisme de l’image. De même, le parti pris osé d’avoir gardé tous les personnages muets (décision qui aurait été impensable pour un grand studio d’animation) contribue à mettre en avant l’aspect purement animal de nos protagonistes. Le pari a payé, étant donné que le film a été couronné de nombreux prix, en particulier les prix du jury et du public au festival d’animation d’Annecy en 2024, le César 2025 du meilleur film d'animation, ainsi que l'Oscar 2025 du meilleur film d'animation. Clément.
Sécurité. Pour accéder au portail de votre bibliothèque, merci de confirmer que vous n'êtes pas un robot en cliquant ici.
- Détails
- Catégorie : Cinéma
Cathy a cinquante-neuf ans et elle vient de perdre son mari.
Sa famille proche et ses amis essaient de la soutenir mais les gaffes et les catastrophes se multiplient ; quand ils ne se montrent pas franchement désagréables. Fine psychologue, Cathy encaisse les reproches et joue le rôle de pierre angulaire dans l'édifice familial et amical. Chaque personnage a son histoire, qui se dévoile peu à peu. Mum est une série britannique qui parle du quotidien avec finesse. Émouvante, drôle et relativement courte, on enchaîne les dix-huit épisodes avec beaucoup de plaisir. Etienne
Sécurité. Pour accéder au portail de votre bibliothèque, merci de confirmer que vous n'êtes pas un robot en cliquant ici.
- Détails
- Catégorie : Cinéma
En 2010, Alexandra Pianelli décide de travailler à mi-temps dans le kiosque familial, situé dans le XVIe arrondissement de Paris.
Elle se met à filmer son quotidien de kiosquière. On découvre une clientèle de passage et quelques habitués. À l’aide de petites maquettes en carton et de petits croquis qu’elle réalise pendant les temps morts de la journée, Alexandra Pianelli nous explique le fonctionnement du circuit de la presse papier, et son déclin progressif face à la presse numérique. Alexandra Pianelli a travaillé six ans dans ce kiosque, coincée derrière le comptoir avec sa caméra fixée sur le front. Ce poste de travail forme naturellement un cadre, délimité par les présentoirs à cartes postales et des murs de magazines (3000 références en stock !). Elle a fait le choix de n’intégrer au film que quelques personnes, que l’on revoit régulièrement. Une jeune danseuse étoile, des retraités bavards, un sdf au grand cœur, des touristes perdus, un vendeur à la sauvette... Ces scénettes souvent drôles et touchantes montrent que le kiosque est à la fois un point de passage et un lieu de rendez-vous important du quartier. Un premier long métrage émouvant sur la vie d’un quartier et sur les difficultés d’un métier et sa potentielle disparition. Etienne
Sécurité. Pour accéder au portail de votre bibliothèque, merci de confirmer que vous n'êtes pas un robot en cliquant ici.
- Détails
- Catégorie : Cinéma
Se réveillant sans aucun souvenir dans une chambre d'hôtel impersonnelle, John Murdoch découvre bientôt qu'il est recherché pour une série de meurtres sadiques.
Traqué par l'inspecteur Bumstead, il cherche à retrouver la mémoire et ainsi comprendre qui il est. Il s'enfonce dans un labyrinthe mystérieux où il croise des créatures douées de pouvoirs effrayants. Grâce au docteur Schreber, Murdoch réussit à se remémorer certains détails de son passé trouble.
Sécurité. Pour accéder au portail de votre bibliothèque, merci de confirmer que vous n'êtes pas un robot en cliquant ici.