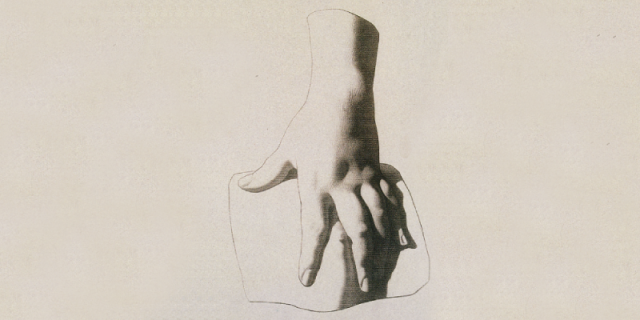Le Vagabond de Tokyo, 1966 / La Marque du Tueur, 1967
La bibliothèque a le plaisir d’enrichir ses collections des deux films les plus importants de la carrière de Seijun Suzuki.
Ce réalisateur encore trop méconnu a pourtant marqué l’industrie Japonaise et a laissé son empreinte dans le cinéma international. Après être rentré dans l’industrie par la petite porte, et sans avoir au départ l’ambition de devenir réalisateur, Seijun Suzuki commence à tourner en 1956 ses premiers films pour les grands studios de la Nikkatsu. Il se fait la main sur le tas, maîtrisant très vite les règles classiques et académiques de la mise en scène et du cadrage. On lui confie des scénarios de « série B » : des longs-métrages à petit budget et aux intrigues vues et revues – généralement des films érotiques ou des histoires de yakuzas remplies de clichés. En à peine onze ans, il réalise près de 40 films pour la Nikkatsu. Assez vite, las de raconter toujours les mêmes histoires et écœuré par les valeurs violentes, chauvines ou patriarcales qu’elles véhiculent, Suzuki glisse petit à petit sa patte dans les œuvres : des cadrages de plus en plus osés, un usage pop et très surprenant des couleurs, des dialogues réduits au strict minimum, et un humour pince-sans-rire frôlant parfois la parodie.
Quand, en 1966, il réalise Le Vagabond de Tokyo, le film est tellement baroque que ses employeurs hésitent à le sortir en salles. L’intrigue est dure à suivre, l’imagerie flirte avec le surréalisme et le héros est régulièrement tourné en ridicule. Aussi, pour son film suivant, menace-t-on le réalisateur : on lui donne une dernière chance, un scénario médiocre inachevé à compléter, un budget rikiki ne permettant même pas de tourner en couleur, et gare à lui s’il s’avise de tourner quelque chose de bizarre !
Une trentaine de jours plus tard, le réalisateur rend sa copie : La Marque du Tueur, chef d’œuvre de Suzuki, de loin le film le plus bizarre de sa filmographie. Il a notamment charcuté l’intrigue pour ajouter des éléments étranges et surréalistes : le héros, un tueur à gages sexuellement excité par l’odeur du riz en train de cuire, est engagé par une femme-papillon pour un contrat qui tourne mal. Il se retrouve alors à son tour cible d’un tueur qui s’amuse à torturer psychologiquement ses victimes en les appelant au téléphone…
Véritable curiosité, tour à tour magistral et expérimental par sa mise en scène et son montage et reposant beaucoup sur le charisme de l’énigmatique Joe Shishido, acteur fétiche de Suzuki ayant subi une opération chirurgicale pour avoir les joues gonflées comme un hamster dans le but qu’on arrête de lui proposer des comédies romantiques, le film est un échec et vaut au réalisateur de se faire licencier, ce qui causa une controverse majeure dans l’industrie cinématographique japonaise. Seijun Suzuki ne put plus réaliser de films avant 1977, mais il ne se remit jamais vraiment de cette déconvenue. Néanmoins ses films, en particulier La Marque du Tueur, redécouverts dans les années 80, inspirèrent fortement de nombreux réalisateurs actuels, de Jim Jarmusch à Tarantino, en passant par Wong Kar-Wai. Clément.